
Dans cette nouvelle ère de pandémie qui ne finit plus, on parle beaucoup de s’adapter.
Et avec raison, on parle d’investissements, de précaution et de prévention.
Mais curieusement, on ne parle pas souvent d’alimentation.
Pourtant, la majorité des problèmes qui nous affligent — de l’obésité aux maladies cardiovasculaires, en passant par le cancer, le diabète, la pollution de nos terres et même le réchauffement climatique — ont tous une souche en commun : ce que nous mangeons.
La bouffe moderne, de sa production industrielle à sa surconsommation démentielle, ne nous a jamais autant fait suer.
Et tué.
Et cruelle ironie, voilà que les récentes statistiques du Centres for Disease and Control concernant la COVID-19 démontrent un lien fulgurant entre l’obésité, les maladies du coeur et… les risques de mourir du virus.
Devant ces constats, et en cette semaine de rentrée scolaire, on profite de l’occasion pour dresser une petite liste de devoirs pour nos élus, question de leur rappeler qu’il y a des solutions à notre portée concernant la nourriture, pour que cela aille effectivement mieux.
Car au-delà d’une nouvelle autoroute, d’un voyage dans le sud ou d’un match de hockey, cette pandémie nous a rappelé que LA chose la plus importante dont nous avons vraiment besoin pour vivre, c’est la bouffe.
Ça, et du papier de toilette.
NOS DEVOIRS POUR LA RENTRÉE
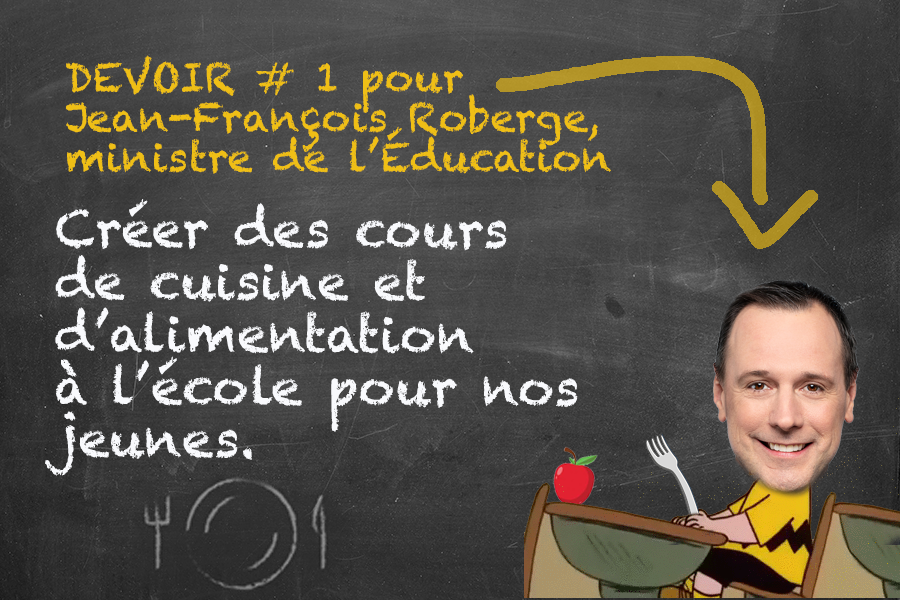
L’alimentation et la cuisine doivent faire leur entrée comme matières à l’école. Et pas comme activité parascolaire. Par la grande porte.
Car nos jeunes ont clairement besoin d’apprentissage à ce niveau, afin de connaître les avantages d’une saine alimentation et les dangers du fastfoodauxquels ils sont constamment exposés.
Selon l’INSPQ (Institut national de santé publique du Québec) et Statistique Canada, 10 % des enfants et adolescents du Québec souffriraient d’obésité et 30 % font de l’embonpoint. Récemment, 221 pédiatres ont signé une lettre ouverte afin « de rappeler l’urgence d’agir afin de contrer l’épidémie » d’obésité qui frappe notre jeunesse.
Et le mois dernier, le Journal de l’Association médicale canadienne suggérait que l’obésité soit traitée comme une maladie. Mais on aura beau classer l’obésité comme maladie tant qu’on le voudra, visiblement, cela ne s’attrape pas en oubliant de se laver les mains. En effet, selon une récente étude de l’Organisation mondiale de la santé, même les pays les plus pauvres du monde sont aux prises avec une épidémie d’obésité à cause de la montée en flèche de la consommation de malbouffe. Quand on sait à quel point les compagnies defastfood visent les jeunes dans leurs stratégies marketing, on peut parler ici de relation de cause à effet.
L’arme la plus redoutable pour lutter contre ce fléau demeure avant tout l’éducation. Alors Monsieur Roberge, pourquoi ne pas parler intelligemment de l’alimentation à nos jeunes, dès le primaire ? Suivi d’un cours obligatoire de cuisine au secondaire ?
Parce que bien manger, c’est comme compter, écrire, attacher ses souliers et gouverner un ministère : cela s’apprend.
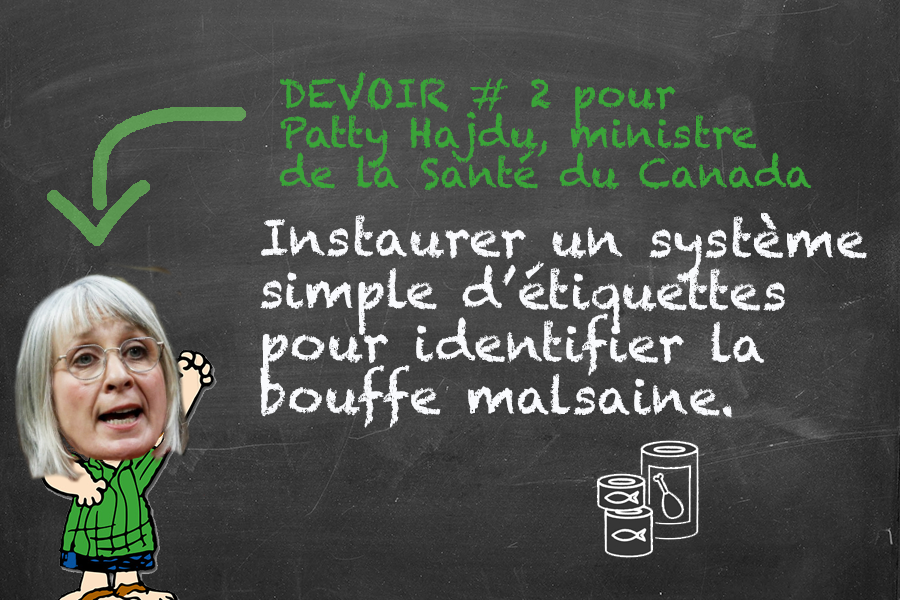
Cela existe au Chili. Au Royaume-Uni. En Hollande. Et en France. Et cela sauve des vies. En effet, le système d’étiquetage qui indique aux consommateurs quels produits contiennent trop de gras, sel, calories ou sucre fonctionne. Au Canada, en février 2018 la ministre de la Santé de l’époque, Ginette Petitpas Taylor, proposait quatre prototypes d’étiquettes, dont une devait un jour être apposée sur les produits malsains. Dans un geste d’ouverture symbolique, on demandait même au public de voter pour leur étiquette préférée.
C’était il y a deux ans. Depuis, après un remaniement ministériel et l’arrivée de Patty Hajdu au ministère, plus rien. Donc comme second devoir, on demande à Madame Hajdu : Est-ce qu’on pourrait s’assurer que le système d’étiquetage ne passe pas à la déchiqueteuse ?
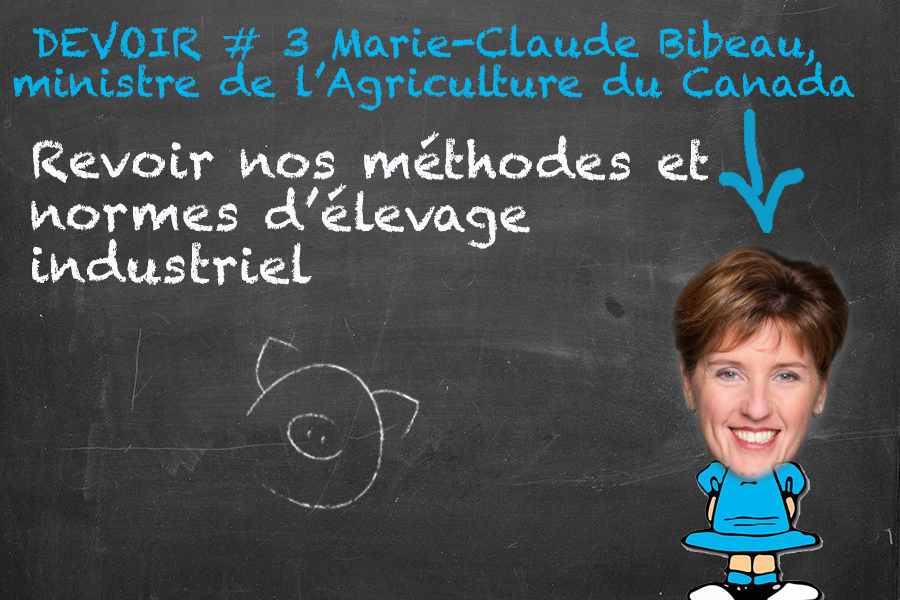
Il y a une inégalité cruellement inexplicable que nous affichons envers les animaux. On adore nos minous et nos toutous. On remue ciel et terre pour protéger les tigres et les baleines. Mais les cochons ? Bof. Pourtant, comme le déclarait si justement l’ex Beatle Paul McCartney : « Si les abattoirs avaient des murs de verre, tout le monde serait végétarien. »
Malgré un mouvement végé qui prend de l’ampleur, il y a 800 millions d’animaux d’abattus au Canada chaque année. Et cet appétit insatiable pour la protéine animale et le développement effréné de l’élevage industriel sont désormais devenus de véritables incubateurs à pandémie.
En plus, ces gigantesques complexes industriels polluent les cours d’eau et contaminent leur entourage, ce qui explique les éclosions récurrentes de salmonelle et E. coli qui contaminent nos oignons et nos laitues. Aux États-Unis, le problème de contamination des eaux est majeur et attribuable à l’ampleur des « CAFOs » — un acronyme pour Concentration Animal Feeding Operations —, des camps de concentration animaliers, gigantesques et industriels qui peuvent héberger des centaines à des millions d’animaux, pour maximiser leur croissance. (Au Canada, on les appelle des « Opérations d’élevage intensif ».)
Leur empreinte écologique est si déconcertante que le sénateur américain Cory Booker propose une nouvelle loi pour les éliminer graduellement d’ici 2040.
Bref Madame Bibeau, il serait grand temps d’emboîter le pas et d’encadrer ces géants.
Avant qu’on se retrouve les pieds dedans jusqu’aux genoux.
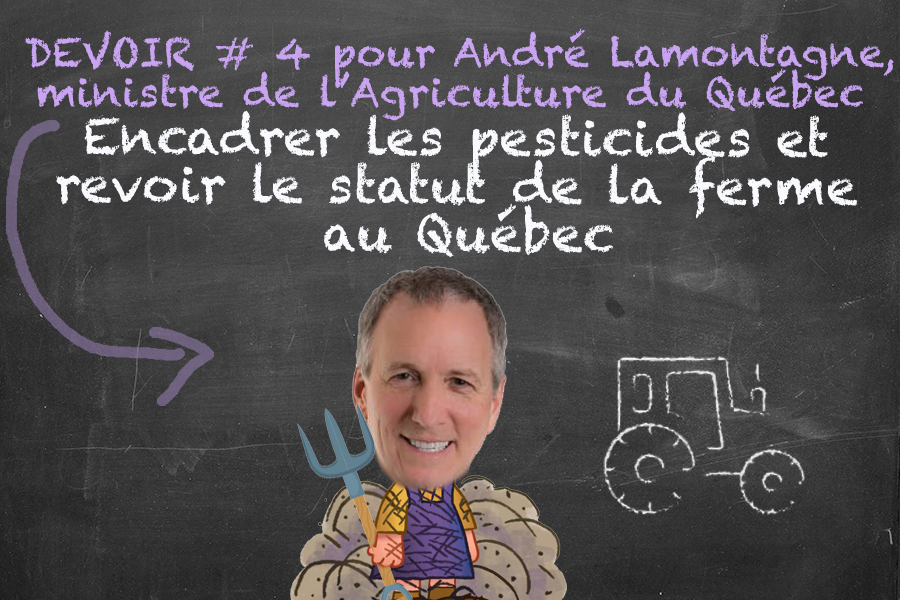
En 2017, au Québec, il s’est vendu 3 348 328 kg de pesticides pour la production végétale, soit l’équivalent en poids de près de 1 760 bélugas — ce qui est évidemment un chiffre fictif puisqu’il resterait seulement un peu plus d’un millier de bélugas dans l’estuaire du Saint-Laurent.
Toujours est-il que face à cette réalité, et aux préoccupations grandissantes dans la population, le gouvernement a produit un beau rapport (bleu) en février dernier sur le sujet, qui ne devait pas contenir de recommandations, puis, après une petite querelle politique comme on les aime, qui en contient finalement 32. Le problème : on nous sert majoritairement un « wish list » plutôt vague et flou, qui relève de l’évidence même, avec des phrases creuses comme : « Que le gouvernement fasse état de la situation des pesticides au Québec et agisse en conséquence, notamment par des mesures d’information et de sensibilisation. » Vous voyez le genre.
Parallèle à cela, il serait grand temps que le gouvernement revoie et revisite aussi le concept de la « ferme » au Québec, qui priorise systématiquement les mégafermes au détriment de tous ces jeunes agriculteurs qui rêvent d’une ferme à taille réduite, accessible, responsable et humaine, mais qui ne cadre pas dans les critères du ministère.
Si vous voulez tenter de comprendre l’absurdité à laquelle fait face toute personne qui veut cultiver la terre ou élever des bêtes autrement au Québec, on vous suggère l’excellent documentaire « La Ferme et son État » de Marc Séguin. (Mais gardez-vous des Gravols pas trop loin, c’est assez étourdissant.)
La bonne nouvelle est que le ministre de l’Agriculture, André Lamontagne, aurait récemment déclaré aux députés qui ont pondu le rapport sur les pesticides qu’un Plan d’agriculture durable serait présenté au mois d’octobre.
On se croise les doigts et on retient notre souffle.
Mais on se réserve le droit de douter.
Et de rêver.
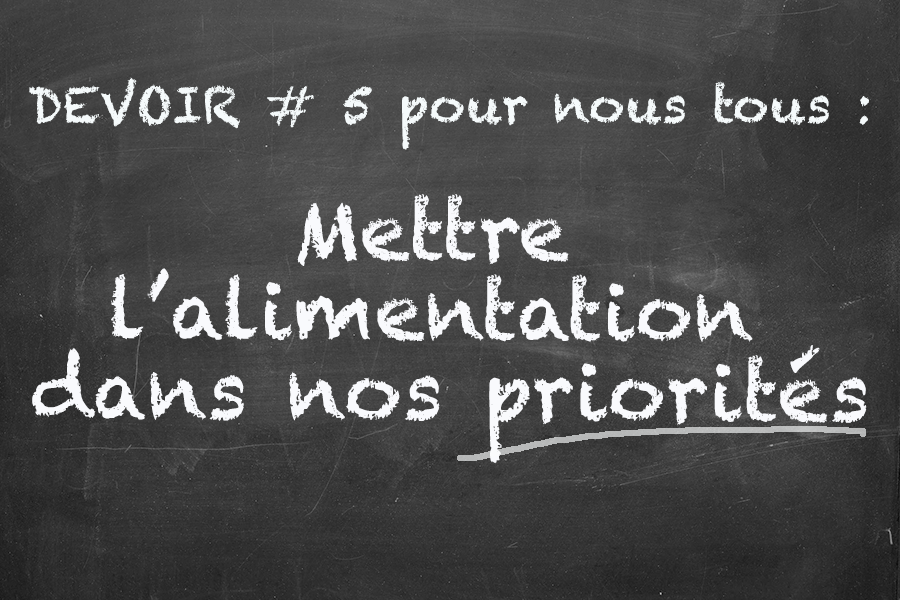
On le sait, quand il s’agit de trouver de coupables, on est plutôt habile à pointer du doigt au Québec. Et même si nos élus on leur part de responsabilités dans l’engrenage alimentaire, il reste qu’une économie de libre marché a ceci de magique : elle réside sur le principe de l’offre et de la demande (sauf pour le milieu artistique, qui est plus axé sur l'offre et la quémande. Mais bon.) Autrement dit, quand il s’agit de manger, nous avons tous ce pouvoir singulier de faire bouger les choses, d’être un « vecteur de contagion » (pour utiliser un terme populaire), par l’entremise des choix et gestes que nous posons, à tous les jours.
Mais pour cela, il faut que l’alimentation soit recentré au coeur de nos priorités.
On doit exhiber la même fougue et passion pour se nourrir qu’on semble avoir pour se divertir ou se vêtir.
Une bonne bouffe ne doit pas être réservé pour le weekend, pour un événement familial ou mondain; cela devrait plutôt être une préoccupation constante, au quotidien.
Et avec les produits québécois qui représentent seulement 5% de ce que nous mangeons, nous sommes nettement plus préoccupés de savoir où sont fabriqués nos chandails, que où pousse notre ail.
Donc, avec cette rentrée qui s’amorce, faisons tous un petit devoir collectif de prendre le temps de mieux manger. De faire des choix alimentaires plus éclairés, que cela soit les produits qu’on consomme ou leur provenance. Et surtout, de ne pas avoir peur de poser des questions et de se remettre en question.
Car le geste le plus concret qu’on peut faire pour notre santé et notre planète, commencera toujours dans notre assiette.
Bonne rentrée.
(Publié le 31/08/2020)
